Exposition
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Du 15 septembre 2021 au 03 janvier 2022
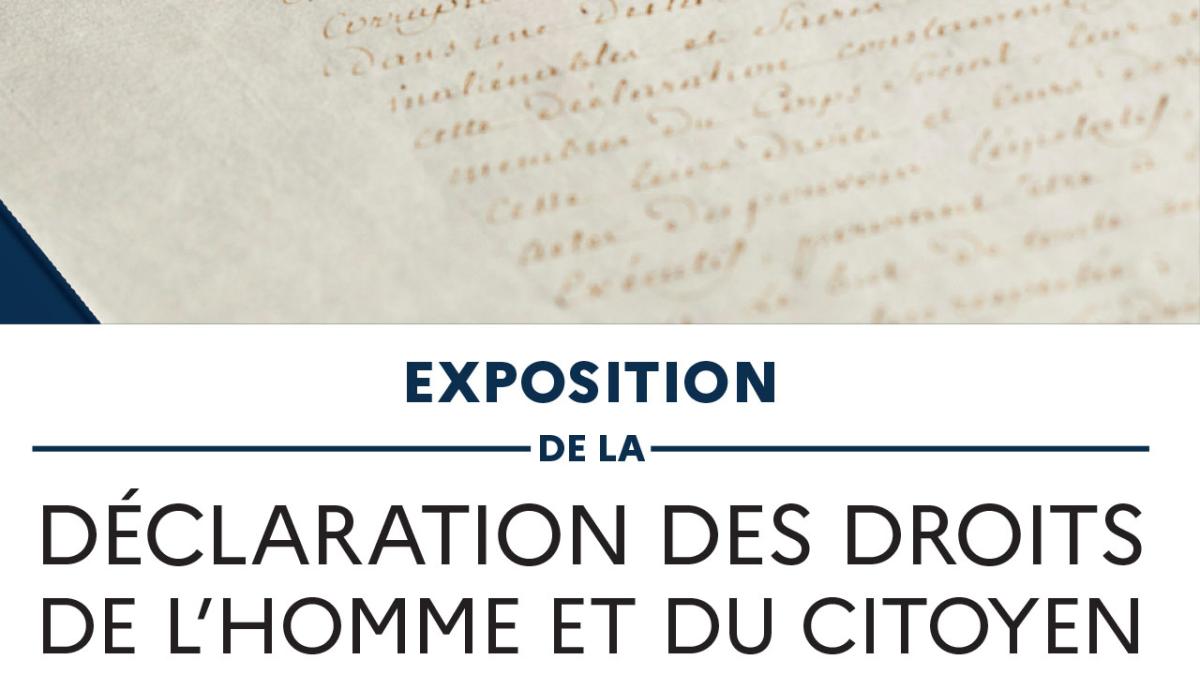
Date et horaire
Du 15 septembre 2021 au 03 janvier 2022
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h – 17h30 Samedi, dimanche : 14h – 17h30, 14h – 19h lors des grandes expositions Fermé tous les mardis Fermeture le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre
Lieu
Le musée des Archives nationales – L’hôtel de Soubise - 60, rue des Francs-Bourgeois - 75003 Paris
AccèsPublic
Tous publics
Dans le cadre du cycle "Les Essentiels".
Adoptée le 26 août 1789 et placée en préambule de la Constitution de 1791, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née des discussions de l'Assemblée constituante. Profondément lié au contexte révolutionnaire, ce texte fondateur abolit l'Ancien régime et pose les bases de la société française et des différents régimes politiques qui se succèdent. Universel, il connait un retentissement international et s'impose définitivement à la postérité.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est inscrite en 2003 par l'Unesco au Registre « Mémoire du monde » qui recense le patrimoine documentaire présentant un intérêt international et une valeur universelle exceptionnelle.
Dès le début du mois de juillet 1789, l'Assemblée constituante entreprend la rédaction d'une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels doit être élaborée la première Constitution française. Votée le 26 août 1789 et placée en préambule de la Constitution de 1791, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'un des textes les plus emblématiques de la Révolution française.
Serment du Jeu de paume
L' Assemblée constituante représente la nation depuis que les députés du tiers état aux États généraux de 1789, rejoints ensuite par ceux de la noblesse et du clergé, ont prêté le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution à la France, le 20 juin 1789, au Jeu de paume.
Différents projets
Le 9 juillet 1789, Jean-Joseph Mounier, rapporteur du comité de Constitution, propose que la future Constitution soit précédée d'une déclaration des droits de l'homme.
Les projets affluent. Ils sont si nombreux que trois comités sont successivement chargés de les examiner et d'en faire la synthèse au cours de l'été 1789.
Néanmoins, le principe d'une déclaration n'est pas acquis. Tout au long du mois de juillet, les députés tentent de définir la marche à suivre pour élaborer la Constitution. Le 4 août, après avoir discuté de la proposition de l'abbé Grégoire de doubler la déclaration des droits d'une déclaration des devoirs, l'Assemblée adopte finalement, à la quasi-unanimité, le principe d'une déclaration des seuls droits de l'homme et du citoyen et décrète que celle-ci précédera la Constitution.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
L'examen des différents projets est retardé par les circonstances. En effet, à la suite de l'annonce des événements parisiens qui provoque la crainte de représailles de l'aristocratie, la Grande Peur déferle sur le pays à partir du 20 juillet. Conjuguée à une crise des subsistances, elle provoque des émeutes qui se transforment le plus souvent en soulèvements des pauvres contre les possédants. Face à leur ampleur, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges féodaux dans la nuit du 4 août.
Voir les 6 pages numérisées, en Salle des inventaires virtuelle
Le travail sur la Déclaration reprend le 12 août, après l'adoption des décrets entérinant les propositions émises durant la nuit du 4 août. Les députés choisissent comme base de discussion le projet du sixième bureau, aux formulations conciliatrices. Discuté article par article entre le 20 et le 26 août, celui-ci ressort profondément modifié du débat. Sur les 24 articles initiaux, seuls deux subsistent sans modification.
Fruit de divers compromis, le texte définitif de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen voté le 26 août 1789 est l'œuvre collective de l'Assemblée.
Articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
ARTICLE 1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
ARTICLE 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
ARTICLE 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
ARTICLE 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
ARTICLE 5
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
ARTICLE 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
ARTICLE 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
ARTICLE 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
ARTICLE 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ARTICLE 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
ARTICLE 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE 12
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
ARTICLE 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
ARTICLE 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
ARTICLE 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
ARTICLE 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
ARTICLE 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Commissaire scientifique de l'exposition : Céline Parcé, responsable des archives des assemblées parlementaires et consultatives. AN. Département de l'Exécutif et du Législatif.
